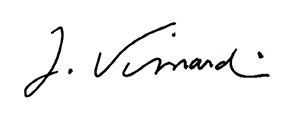1960 – 1980
Jacques Vimard au jardin de Cézanne
(Le Figaro, Michel Daubert, 30 nov 1970)
« Dans ce concert hétéroclite, Vimard a décidé de rester peintre, c’est-à-dire de prolonger à sa maniere et jusqu’à autres incandescences une technique de révélation poétique aussi vieille que l’homme.
Entre l’échappée trop belle de la non-figuration et les scléroses du réalisme, Vimard se taille avec vigueur un chemin différent. »
Les visages de Vimard
(Arts, Alain Bosquet, 1976)
« À trente-quatre ans, Jacques Vimard fait une entrée hallucinatoire en peinture par une série de portraits – autoportraits en réalité– dont on ne peut sortir indemne… Nos peintres tragiques sont rares. Jacques Vimard l’est avec une émouvante et terrible intériorité. »
Et si la peinture disait toujours le sexe ?
(Le Quotidien de Paris, Gilles Plazy, 1976 (extrait))
« Voici un peintre. La chose est suffisamment rare pour être remarqué. Jacques Vimard a trentre trois ans mais déjà la maturité qui lui permet de s’être trouvé un chemin à nul autre pareil.
… C’est un peintre de l’expérience intérieure, physique plus que du regard, et c’est l’intérieur des choses qui le requiert, non leurs formes. »
Et si la peinture disait toujours le sexe ? Quelle pratique érotique est la peinture et quels déguisements elle sait donner au désir, quelle façon elle a aussi de prendre son plaisir, c’est ce dont témoigne avec un culot monstre la peinture de Jacques Vimard. »
Vimard est de ces peintres pour qui peindre c’est exalter la peinture
(Le Quotidien de Paris, Gilles Plazy, 1976)
Et celle-ci avant d’être un art, donc l’ensemble des œuvres faites à ce titre, c’est une matière. C’est par un certain usage de cette pâte colorée, onctueuse, livrée en tubes qu’ils font le tableau – fidèle en ceci à la tradition de la peinture à l’huile. Une certaine densité crémeuse, des odeurs et le jeu d’infinis mélanges sur la palette comme on touille les ingrédients d’une sauce… Une telle sensualité, une telle gourmandise, seules peuvent faire comprendre cet arrière de la peinture hors de quoi tout discours critique est sans racines et c’est par l’étude de ces actes premiers que devrait commencer toute analyse de la peinture car ce qui est donné à voir contient, même s’il s’en cache, tout le processus de sa mise jour. Vimard est de ces peintres qui ont les mains sales à force de presser les tubes et manier les pinceaux, à l’ancienne, entre le pouce et l’index. Et le geste par lequel il exprime la couleur hors du tube n’est déjà que l’anticipation métaphorique de son effort pour tirer de lui-même ces images qui ne sauraient être que mises en pâte. Ce n’est que dans un tel acte de peindre, avec la lenteur de la peinture à l’huile qui sait patienter pour attendre le peintre, qui sait le temps d’une maturation, que Vimard peut donner forme. La peinture n’est pas que le médium dont il se sert pour fixer l’image, c’en est le révélateur – l’indispensable bain dans lequel il faut que se trempe l’esprit pour produire l’image. Autant dire que chez ce peintre aussi violemment figuratif la peinture a toujours un double sujet : la peinture elle-même et le sujet lui-même.
C’est bien ici la peinture qui peint, pas le dessin. Vimard n’est pas homme de la ligne, non plus que de la précision figurative. C’est un peintre de l’expérience intérieure, physique, plus que du regard et c’est l’intérieur des choses qui le requiert non leur forme. D’où sa fidélité, pour une période, à un thème qu’il ne saurait délaisser tant qu’il ne l’a pas expurgé, expulsé. Dans ce tête à tête quotidien avec la peinture, dans la solitude de l’atelier, Vimard ne cesse de se mettre en jeu, en joue. Comme si c’était à quelque démon en lui qu’il faut tordre le cou (ainsi dit ceci peut paraitre banal, lot de nombreux peintres, mais ce que les mots ne peuvent ici qualifier c’est l’intensité de cette lutte). S’étonnera t-on alors que sa peinture ait si souvent couleur de chair blessée sanguinolente et molle viande, visage triste, sexe affligé ?
Dans la période, avant-dernière, des « Visages » c’est loin que Vimard a poussé la rituelle expérience de l’autoportrait (qui le connaît n’hésite pas à l’y reconnaître). Ce cadrage sur le centre du visage qui supprime tout fond sur lequel il se détacherait. Privilégiant, les yeux, le nez, la bouche en accuse l’expression mélancolique, douloureuse (mais sans atermoiement ni complaisance). Et, l’agrandissement aidant, c’est jusqu’à une intolérable présence que Vimard a poussé cette représentation que Le regard, à l’échelle du mur, ne saurait éviter. Quelle lacune lui aura-t-il fallu combler pour se donner de si imposantes compagnies, quel désir d’être aura présidé un tel élargissement de l’image ? Peu de peinture, en un temps qui ne craint pas la profusion des images, m’auront paru aussi fortement nécessaires, imposées par d’aussi profondes, irraisonnables pulsions. En se retournant ainsi vers lui-même, au fond de lui-même, après de plus anecdotiques sujets, ce que Vimard aura mis à jour ce n’est pas moins que l’irrécusable expérience d’un peintre qui se peint sous forme de peinture. Dans ses Visages la peinture n’est jamais l’attribut d’une forme et la couleur ne sert pas à masquer les vides du dessin ; c’est la matière même de la peinture qui inscrit l’image dans l’acharnement des touches par quoi se constitue peu à peu le tableau comme figure. La violence d’une telle peinture n’est pas le produit d’un geste de fureur mais d’une mise au point attentive, d’un désir forcené de parvenir à ses fins qui ne peuvent être que tout dire, c’est-à-dire trouver la forme exacte de son expression.
Chez Vimard l’image se ramène au plus près du plan, dans un absolu premier plan (sans arrière) qui l’impose et qui interdit toute mise en scène. C’est pourquoi on ne saurait y échapper. C’est ce qui rend si lourds de tels monumentaux visages. Déjà beaucoup d’audace, une singulière façon de ne laisser aucun répit, aucune échappatoire, à celui qui regarde. Mais, pire, le visage, a débouché sur le sexe. Du visage au sexe le chemin n’est pas long – nul besoin de psychanalyste pour l’affirmer ; mais personne n’avait rendu ce lien aussi évident, non pas dans le rapprochement d’un tableau (ce qui est toujours par association d’esprit, d’image chose facile) mais dans le développement d’une expérience de peintre. II faut voir ces deux séries l’une par rapport à l’autre pour bien en comprendre les fondations, pour voir comment l’un prend la place de l’autre. Et si ce que disait auparavant le visage c’était déjà le sexe ? Et si la peinture disait toujours le sexe ? Quelle pratique érotique est la peinture et quels déguisements elle sait donner au désir, quelle façon aussi elle a de prendre son plaisir, c’est ce dont témoigne avec un culot monstre la peinture de Jacques Vimard. Ce que tente plus ou moins de refouler toute peinture : l’autoportrait n’est pourtant que l’avouable travestissement du sexe. Mensonge auquel Jacques Vimard, au point de son parcours aujourd’hui atteint, ne peut plus céder. Mais saurons-nous voir avec lui combien le roi-peintre est nu ?. »
Jacques Vimard le peintre du désordre et du silence
(Havre Libre, 1978, Daniel Fleury, Paris Normandie, Florence Vercier, 1978)
« Le mot sexe, peut faire peur, Vimard le sait et ne se veut pas provocateur il répond : »le sexe c’est à la fois la tête, la terre, sa boue, la pliure, le battement, la vie sans cesse renouvelée. Puis il ajoute : je suis peintre du désordre et du silence. Je ne fais aucune référence à l’image. Je me moque du dessus et du dessous. L’entrée ne m’intéresse pas plus que la sortie. »
…En fait, si Vimard se dit peintre de désordre et de silence c’est avant tout par humilité devant les palpitations du monde. »
Une toile vivante comme un épiderme
(La Derniere Heure Lyonnaise, R. Dérouville, 1979)
« De nos jours où l’art se déshumanise (ou s’intellectualise) souvent, une telle peinture généreuse et libre, fait du bien. Vimard tient à se situer hors de toute époque. L’art doit aller au-delà de la mode. Il faut donc le considérer comme prenant place dans la lignée des grands lyriques qui ont dans la matiere colorée interrogée de tout temps, la nature pour aller toujours pres de ce noyau d’inconnu autour duquel gravite la vie. »
À saint-Jean : Nuagisme charnel de Vimard
(Le Progres, E. Gerome, 1979)
« Vimard désire vaincre l’inertie pesante de la Chair, matiere vivante où il puise son inspiration lyrique. « Deux immenses toiles roses, somptueuses dans les plis et replis desquelles l’œil se promene, se perd. Un espace qui pourrait être cosmique, des mamelons et des profondeurs qui pourraient être montagnes et cavernes, qui pourraient être aussi seins et sexes, qui sont tous cela à la fois et d’autres choses encore :
« Je voulais faire des paysages, explique Jacques Vimard, et en Ardeche il y a une montagne qui, vers cinq heures, quand l’ombre vient, prend une forme molle, un peu comme un sexe. Parallelement j’ai fait des natures mortes, des citrons et le bout du citron, c’était un peu comme le téton d’un sein. » … « La peinture devient une partie de moi-même. »
Vimard le Tourbillon rose des alcôves
Vimard nous entraîne dans le tourbillon rose de ses obsessions, rose et chaud comme une alcôve. Le regard se perd dans les plis, se love dans les creux ombreux, glisse sur les volumes pleins des lobes et des mamelons. Les chairs sont nacrées, violacées, enflammées du plaisir d’être chairs. Vimard lance une invitation au voyage à travers un paysage charnel. »